Par Charlotte Arce
Prostituées « tradi » de la rue Saint-Denis, escorts de luxe, dominas dans un donjon BDSM à Londres… Dans son livre Vilaines Filles (éd. Anne Carrière, 2020), la journaliste Pauline Verduzier dresse le portrait de personnes ayant décidé de vivre du travail du sexe, mais aussi de leur clientèle féminine. Loin des clichés et en s’affranchissant des stigmates qui leur collent à la peau.
Lorsque l’on parle de prostitution, ce sont souvent les mêmes images qui nous reviennent en tête. Julia Roberts, toute en cuissardes et mini-jupe dans Pretty Woman. Les « filles de joie » dans les romans de Maupassant et dans les peintures de Toulouse Lautrec. Ou encore – et c’est plus probable – des silhouettes indistinctes, juchées sur des talons, qui se penchent à la fenêtre des voitures le long du périphérique ou qui attendent les clients à la lisière des bois.
Pourtant, le travail du sexe est infiniment plus complexe et multiple que ces représentations qui, si elles sont en partie vraies, sont loin de correspondre à la norme. Qui sont aujourd’hui les femmes, les hommes, les personnes non-binaires qui ont décidé de faire commerce de leur corps ? Quelles sont leurs motivations, leur vécu, leurs attentes vis-à-vis de cette activité ? Et celles des femmes qui font appel à leurs services ? Ce sont ces questions que Pauline Verduzier a voulu explorer.
Journaliste spécialiste des questions de genre et de sexualité, aussi membre du collectif « Les Journalopes« , Pauline Verduzier s’intéresse depuis plusieurs années aux travailleur·se·s du sexe (TDS), à qui elle a consacré des reportages pour Vice, NEON et l’émission de France Culture « Les Pieds sur Terre ». De ces rencontres, elle a tiré un livre, Vilaines Filles, publié en octobre dernier aux éditions Anne Carrière. Une enquête passionnante qui va à rebours des préjugés dont pâtissent aujourd’hui les TDS – majoritairement des femmes – considéré·e·s comme « subversives« , « aguicheuses« , « immorales« . Des « vilaines filles » qui « ne se conforment pas à ce qu’on attend d’elles d’un point de vue sexuel ou de leur attitude vis-à-vis de leur corps et vis-à-vis des hommes » et qui sont en cela distinctes des « femmes respectables », nous explique Pauline Verduzier. « Cette manière de distinguer les femmes respectables des femmes indécentes en fonction de leur sexualité réelle ou supposée est une façon de contrôler les femmes et leurs corps« , analyse-t-elle.
Ni mamans, ni putains
Celles et ceux que rencontre Pauline Verduzier ont justement décidé de se réapproprier leur corps et le discours que l’on tient sur lui, qu’ils·elles monnayent des faveurs sexuelles ou payent pour du sexe. Travailleuses pour un bordel légal de Genève, escorts de luxe à leur compte, « traditionnelles » de la rue Saint-Denis ou du Bois de Boulogne, dominas dans un donjon londonien, masseuses dans un salon tantrique new-yorkais, clientes d’une maison close lesbienne d’Amsterdam… Ce qui frappe, à la lecture de Vilaines Filles, c’est la multiplicité des parcours de vie et des motivations. « J’ai rencontré une cinquantaine de personnes et ça n’est jamais la même histoire« , témoigne la journaliste, qui dit avoir trouvé face à elle des « interlocuteur·ice·s passionnant·e·s pour parler de sexualité, de désir, de normes de genre ». « Ce sont des personnes dont la parole est confisquée, qu’on n’interroge jamais sur leur vécu, leurs besoins, leur ressenti. »
Leur discours est pourtant précieux pour déconstruire ce mythe toujours prégnant de « la maman et la putain », qui classifie les femmes en deux catégories : les « respectables » et les « indésirables ». « Il y a toujours cette binarité entre celles qui sont considérées comme filles faciles et les autres. On l’a encore vu avec le récent débat sur les crop tops dans les collèges et les lycées. C’est une dichotomie qui emprisonne toutes les femmes« , estime l’autrice. Interroger les travailleur·se·s du sexe questionne aussi notre propre rapport aux injonctions patriarcales, à la sexualité.
À travers le regard de Pauline Verduzier, toujours bienveillant, jamais surplombant, on apprend à connaître Laura, ancienne hôtesse de charme dans une maison close suisse et aujourd’hui escort à Paris. Ou encore Mylène Juste, 50 ans, militante TDS qui travaille rue Saint-Denis et Sophie, opératrice du téléphone rose dont l’activité se mue parfois en séance de psy. « Les quinze premiers jours du confinement, les conversations tournaient très peu autour du sexe. On a servi de psychanalystes. On était là pour les rassurer« , raconte-t-elle. Il y a aussi Romain, un ancien ouvrier du bâtiment de 39 ans reconverti dans l’escorting de luxe, dont les clientes se sont confiées à Pauline Verduzier. « On pourrait croire qu’un gigolo passe du bon temps avec les femmes, mais ce n’est pas forcément comme ça que je vois les choses. On est vraiment à la disposition des client·e·s et c’est leur plaisir avant tout qui compte« , affirme-t-il.
La journaliste lie ces témoignages à ses propres expériences, amoureuses et sexuelles pour « tordre le cou à l’altérisation des TDS ». « Je voulais aller plus loin que le simple témoignage en questionnant mes propres représentations en tant que journaliste, femme et personne non-TDS, et montrer qu’il y a un continuum de réalité entre leur vécu et celui de toutes et tous. Les TDS ne sont pas ces êtres exotiques, très éloignés de nous comme voudraient nous le faire croire certaines représentations.«
Une réalité multiple et complexe
Si le récit est émaillé de portraits mémorables – on pense notamment à celui de Rita, qui a vécu sa première expérience lesbienne à l’âge de 89 ans avec une TDS–, il aborde aussi les enjeux et les difficultés du travail du sexe. Au gré des expériences, sont tour à tour évoqués le militantisme, les mauvais payeurs, la solidarité entre TDS pour se protéger des clients violents, l’absence de protection sociale ou encore l’insécurité financière, aggravée depuis 2016 par la loi sur la pénalisation des clients. « Ces histoires ne sont jamais vraiment binaires, il y a à la fois des formes d’oppression et d’autonomie qui cohabitent. Ce qui est souvent le cas dans beaucoup de réalités humaines« , souligne Pauline Verduzier.
Il est aussi question de la traite d’êtres humains à travers sa rencontre poignante avec Beauty, une Nigériane de 24 ans longtemps forcée par sa madam (proxénète) à se prostituer et qui vient d’entamer un parcours de sortie de la prostitution (PSP). Mis en place en 2016, ce dispositif lui permet d’obtenir un titre provisoire de séjour et une allocation de 330 euros par mois. Sans prendre position dans le brûlant débat opposant militant·e·s abolitionnistes et pro-sexe, Vilaines Filles donne à voir deux réalités, diamétralement opposées mais souvent amalgamées. « C’est vraiment un des plus gros enjeux quand on écrit sur ce sujet : sortir de cette binarité avec, aux deux pôles, les escorts de luxe qui auraient choisi ce métier et seraient dans un épanouissement total, et les victimes de la traite d’êtres humains qui n’auraient aucune possibilité d’autonomie. Les deux existent, mais il y a évidemment une pluralité de situations entre ces deux pôles qu’il fallait raconter. »
L’épreuve du coronavirus
Commencé pendant le confinement, Vilaines Filles livre une réflexion nécessaire sur la protection qu’accorde notre société aux travailleur·se·s du sexe. Économiquement fragilisé·e·s par la crise sanitaire, certain·e·s ont migré sur Zoom ou OnlyFans, tandis que d’autres n’ont eu d’autre choix que de se mettre en danger pour pouvoir continuer à exercer leur métier. Outre le risque de tomber malades, les TDS risquent d’être contrôlé·e·s par la police ou d’être les victimes de client·e·s cherchant à négocier les tarifs à la baisse.
Pour pouvoir vivre correctement, se nourrir et payer leur loyer, les cagnottes solidaires, lancées par des associations et nourries de dons personnels, se sont révélées précieuses. « Il y a même des TDS qui ont participé à des cagnottes de collègues qui étaient dans une situation encore plus précaire qu’elles·eux. » Mais ces dons ne peuvent suppléer l’aide de l’État, quasi-inexistante depuis près d’un an, malgré la mobilisation des associations de santé communautaire (Aides, Acceptess-T et le STRASS) pour allouer un fond d’urgence. « Elles réclamaient notamment le déblocage de l’argent, qui normalement sert aux parcours de sortie de la prostitution, mais qui est, selon certains députés qui connaissent le sujet, pas ou mal utilisé. Elles ont finalement reçu un chèque, perçu cet automne. En attendant, ce sont elles qui ont pallié le manque d’aides. »
Le livre s’achève sur une note cocasse et optimiste : un cours de fessée. Alors que des hommes tendent leur postérieur dénudé, on prend conscience du renversement des valeurs qui est en train de s’opérer. Ici, pas de femmes soumises, ce sont les hommes qui se plient volontairement aux ordres de leur « maîtresse ». Ou quand les « vilaines filles » renversent les normes sexistes de genre. À quand le même chambardement dans notre société ?
Abonnez-vous et recevez chaque samedi notre newsletter féministe et participative
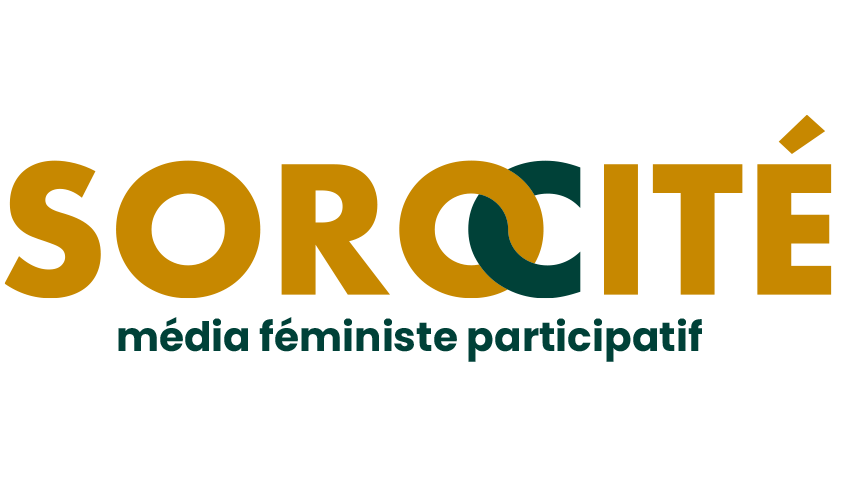

Bon jour,
Personnellement j’attends que les hommes puissent mettre des robes, porter des talons … travailler dans des secteurs en grandes majorités féminisées : administration comme par exemple la la santé, l’intérieur … et les emplois : infirmières, sages-femmes, etc etc et tout cela sans les préjugés, les moqueries, les attaques …
L’égalité est actuellement un leurre et n’apporte pas grand chose… il faudrait mettre en avant l’aspect Humain dans toutes ses nuances, au lieu, comme toujours, d’enfermer les genres … de fait, mettre en place un équilibre … mais bon …
Max-Louis
J’aimeJ’aime